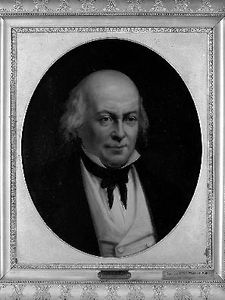 Pierre Jean de BÉRANGER
Pierre Jean de BÉRANGER
Lorsque Pierre Jean de Béranger compose les paroles de cette chanson, peut-être repense-t-il aux jours où, accablé de pauvreté il vivait sous les toits du Boulevard Saint-Martin avec sa maîtresse et cousine Adélaïde.
« Sois-moi fidèle, ô pauvre habit que j’aime,
Ensemble nous devenons vieux,
Depuis dix ans je te brosse moi-même,
Et Socrate n’eut pas fait mieux.
Quand le sort à ta mince étoffe
Livrerait de nouveaux combats
Invite-moi, résiste en philosophe :
Mon vieil ami ne nous séparons pas.
Je me souviens, car j’ai bonne mémoire,
Du premier jour où je te mis :
C’était ma fête et, pour comble de gloire
Tu fus chanté par mes amis ;
Ton indigence qui m’honore
Ne m’a point banni de leurs bras ;
Tous ils sont prêts à nous fêter encore :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas !
À ton revers j’admire une reprise,
C’est encore un doux souvenir :
Feignant un soir, de fuir la tendre Lise,
Je sens sa main me retenir,
On te déchire, et cet outrage
Auprès d’elle, enchaîne mes pas.
Lisette a mis trois jours à tant d’ouvrage :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas !
T’ai-je imprégné des flots de musc et d’ambre
Qu’un fat exhale en se mirant ?
M’a-t-on jamais vu dans une anti-chambre
T’exposer au mépris d’un grand ?
Pour des rubans la France entière
Fut en proie à de longs débats ;
La fleur des champs brille à sa boutonnière :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas ! »
C’est encore cette vie de bohème des jours quand même joyeux, qu’il évoque dans cette autre romance :
« Je viens revoir l’asile où ma jeunesse
De la misère a subit les leçons.
J’avais vingt ans, une folle maîtresse,
De francs amis et l’amour des chansons.
Bravant le monde et les sots, et les sages,
Sans avenir, riche de mon printemps,
Leste et joyeux, je montais six étages.
Dans un grenier qu’on est bien à vingt ans !
Dans un grenier, point ne veux qu’on l’ignore.
Là fut mon lit bien chétif et bien dur ;
Là fut ma table : et je retrouve encore
Trois pieds d’un vers charbonné sur le mur.
Apparaissez, plaisirs de mon bel âge,
Que d’un coup d’aile a fustigé le Temps.
Vingt fois pour vous j’ai mis ma montre en gage.
Dans un grenier qu’on est bien à vingt ans !
(…)
Quittons ce toit où ma raison s’enivre.
Oh ! Qu’ils sont loin, ces jours si regrettés !
J’échangerais ce qu’il me reste à vivre,
Contre un des mois qu’ici Dieu m’a comptés,
Pou rêver gloire, amour, plaisir, folie,
Pour dépenser sa vie en peu d’instants,
D’un long espoir pour la voir embellie.
Dans un grenier qu’on est bien à vingt ans ! »
(1828) (Extrait de « Le grenier »)
Béranger est le fils d’un homme aventurier et d’une mère volage qui l’abandonne. Béranger raconte :
« Dans ce pays plein d’or et de misère,
En l’an du Christ 1780
Chez un tailleur, mon pauvre vieux grand père
Moi, nouveau-né, sachez ce qui m’advint. »
Béranger écrira des chansons et des poèmes qui encouragent à boire, mais il ne boira pas trop lui-même. Placé chez un orfèvre, puis un juge de paix, à douze ans, il devient apprenti typographe et se lie d’amitié avec le fils de l’imprimeur qui lui donne des leçons de grammaire et l’initie aux règles de la versification. Écrire en vers sont des banalités pour les jeunes gens du 19ème siècle !
Béranger dévore tous les classiques de Racine à Voltaire. Son regret le plus vif est de ne pas savoir écrire le latin. Il s’en frappe la poitrine, le déplore !
En 1837, Arago dans une discussion sur l’enseignement, clame : « Un poète dont tout le monde sait les vers par cœur, ce n’est pas monsieur de Lamartine, mais Béranger ! Eh ! bien, Béranger ne sait pas le latin ! »
Il a dix-sept ans, quand il revient à Paris, sa ville natale. Son père le réclame. Après des complots avec les royalistes (il a même frisé la guillotine ce père !) il n’a pas hésité à se fabriquer une généalogie nobiliaire, se baptisant Jean-François de Béranger de Mersix !
Notre poète, accepte en héritage la première particule, ce qui lui est reproché sous la restauration. Il sympathise avec les sans-culottes et lance à ses détracteurs :
« Hé quoi ! J’apprends que l’on critique le « de « qui précède mon nom :
Êtes vous de noblesse antique ?
Moi noble ? Oh ! Vraiment non ! »
Il ne déplore pas la mort de son père, homme inconstant et sans tendresse et écrit ainsi à un ami :
« Si vous me voyez tout en noir, c’est que je suis trop gai, sans trop savoir pourquoi ! »
Béranger taquine la muse, fréquente les cabinets de lecture et les cabarets où celui qui est l’auteur d’un mauvais poème est impitoyablement condamné à cette suprême injure pour une compagnie dont la devise est celle-ci :
« Tous les méchants sont buveurs d’eau, c’est bien prouvé par le déluge ! »
Béranger n’est ni ivrogne, ni libertin ; il est plutôt timide, même si son inspiration est d’abord galante, et quasi pornographique.
Des générations ont chanté dans les ateliers, les mariages, les soirées ses fameuses chansons coquines, dont, la plus célèbre « Ma grand-mère » comporte des sous-entendus à faire rougir les uns, sourire les autres :
« Ma grand-mère, un soir à sa fête,
Du vin pur ayant bu deux doigts,
Nous disait en branlant la tête :
Que d’amoureux j’eus autrefois !
Combien je regrette,
Mon bras si dodu,
Ma jambe bien faite,
Et le temps perdu !
(…) »
Quand il rencontre la blonde Judith aux yeux bleus, Béranger est séduit. Elle est distinguée, discrète et chante à ravir. Il se met à vivre avec elle. Les vers, ni les chansons ne nourrissent les tourtereaux. La pauvreté les accable. Bonaparte ne goûte pas le grivois : les arts se doivent de servir l’armée.
Béranger tente l’envoi de deux poèmes accompagné d’une lettre à Lucien Bonaparte !
- « Monsieur, vous qui protégez les Beaux-Arts, la poésie serait-elle moins heureuse auprès de vous ?... Je n’ai que 23 ans et j’ose me croire capable de faire mieux quand le joug de l’adversité ne pèsera plus sur moi... »
Trois jours plus tard, il est convoqué et se présente vêtu d’un pauvre habit  ravaudé par Judith. Il va connaître douze années de répit. Il bénéficie d’un traitement qui lui permet, sans trop de tracas, de s’instruire et d’affiner sa lyre; mais il se voit contraint d’écrire des poèmes de circonstances qui louent le 18 Brumaire et le Concordat. Béranger connaît très vite la notoriété, car en quelques mois la France entière fredonne « Le Petit homme gris » et le « Roi d’Yvetot ». Il a trente-trois ans et dix milles exemplaires de ses chansons se vendent en dix jours.
ravaudé par Judith. Il va connaître douze années de répit. Il bénéficie d’un traitement qui lui permet, sans trop de tracas, de s’instruire et d’affiner sa lyre; mais il se voit contraint d’écrire des poèmes de circonstances qui louent le 18 Brumaire et le Concordat. Béranger connaît très vite la notoriété, car en quelques mois la France entière fredonne « Le Petit homme gris » et le « Roi d’Yvetot ». Il a trente-trois ans et dix milles exemplaires de ses chansons se vendent en dix jours.
Même les illettrés connaissent par cœur ses textes, car ils se répètent dans la rue, au café, dans les ateliers et à la veillée dans les villages. « Je peux me passer d’imprimerie ! » écrit Béranger.
En 1821, le voila condamné pour atteinte à la morale religieuse. Il n’est pas athée, mais il n’admet pas qu’on fasse du christianisme une arme politique. « Les deux sœurs de charité » scandalise, quand à la chanson du Bon Dieu, elle s’attaque à la personne même du Roi !
Le procès de Béranger a lieu en cour d’assises. Le tout Paris est là et envahit le palais de justice. À cause de la foule trop immense, Béranger entre en sautant par la fenêtre et hurle :
« On ne peut commencer sans moi ! »
Les avocats, les magistrats aussi quémandent des autographes. Toutefois Béranger n’échappe pas à la prison où il restera trois mois avec 500 francs d’amendes à payer. La prison est l’apothéose de sa consécration. Il est le poète national, le chantre de la liberté.
De toute la France, il reçoit des victuailles : du foie gras du Périgord, des fromages de Brie, des cornichons de Touraine, du vin de Saumur et de Bourgogne. Sa seule inquiétude : celle de trop manger. Il ressort de prison, bedonnant, mais insoumis !
Ses attaques de moins en moins déguisées contre la Monarchie et l’Église le font entrer vivant dans la légende. Ses nouvelles chansons se vendent en trois jours et la police ne parvient pas à les saisir ! En 1825, Béranger est de nouveau condamné. Cette fois, à neuf mois de prison et dix milles francs d’amendes. Une souscription publique est levée, l’amende est payée en quarante-huit heures et ses chansons interdites sont clandestinement diffusées à plus de cent milles exemplaires. Comme la première fois, la nourriture afflue de toutes les provinces.
 « Comme je suis gâté ! Il ne me manque plus qu’un bon estomac ! » dit Béranger, qui voit défiler dans sa cellule toutes les célébrités d’alors pour le serrer dans leur bras, dont Lafayette, Chateaubriand, Victor Hugo, Alexandre Dumas.
« Comme je suis gâté ! Il ne me manque plus qu’un bon estomac ! » dit Béranger, qui voit défiler dans sa cellule toutes les célébrités d’alors pour le serrer dans leur bras, dont Lafayette, Chateaubriand, Victor Hugo, Alexandre Dumas.
C’est à lui, que sera remis le drapeau tricolore qui remplacera définitivement le drapeau blanc. Mais Béranger refuse toute compromission et tout poste. Il s’en explique ainsi :
« La Révolution de Juillet a voulu faire ma fortune, je l’ai traitée comme une puissance qui peut avoir des caprices auxquels il faut être en mesure de résister. J’aurais pu avoir ma part à la distribution des emplois. Malheureusement, je n’ai pas l’amour des sinécures. »
Béranger pense que la République idéale ne sera que pour l’an 2000 !
Quand la révolution consommée, Béranger est convié aux Tuileries par Louis Philippe, il décline l’invitation, prétexte son âge. En réalité pour préserver son indépendance, Béranger choisit la solitude et la modestie. Il est de ceux que l’admiration fatigue et que la louange blesse. Généreux, discret, alors qu’il est peu fortuné, il fait libérer Rouget de l’Isle emprisonné pour dettes, car la « Marseillaise » ne l’a point enrichi. Béranger l’aidera jusqu’à sa mort.
À cinquante-trois ans, il écrit à un ami :
« Je vieillis beaucoup... le chansonnier est bien mort, seul survit un humble philosophe, un vieil ermite. »
 En 1836, il décide de s’installer en Touraine. Il loue la Grenadière à Saint-Cyr, où Balzac avait fait un bref séjour avec Mme de Berny. Non sans péripétie, il s’installe, après avoir surmonté l’épouvante de loger dans une habitation si célèbre. L’hiver cette année là est très rigoureux, et celui de l’année suivante plus encore.
En 1836, il décide de s’installer en Touraine. Il loue la Grenadière à Saint-Cyr, où Balzac avait fait un bref séjour avec Mme de Berny. Non sans péripétie, il s’installe, après avoir surmonté l’épouvante de loger dans une habitation si célèbre. L’hiver cette année là est très rigoureux, et celui de l’année suivante plus encore.
Béranger est dégoûté du jardinage. Il écrit :
« Il faut que vous sachiez qu’entre autre chose le Jardin de la France n’a que des fruits très médiocres. Ajoutez à cela l’entêtement des Tourangeaux à se croire les privilégiés de la création : de bonnes gens, du reste, tout fiers d’avoir produit Rabelais, moins compris ici, que partout ailleurs ! »
Toutefois, le moindre rayon de soleil chasse la mélancolie de Béranger ; loin des aspirations politiques ou sociales, il chante en Touraine, le merle, la colombe et la tourterelle.
« Oiseaux, merci ! Rome fut sage
De vous consultez autrefois.
Je vais au prochain rivage,
Vivre en un coin, sous d’humbles toits.
Ici, vous qui du vieil ermite
Picoriez en paix les raisins,
S’il a des arbres pour voisins,
Venez charmer son nouveau gîte,
Oiseaux, adieux. Peuple heureux et chéri,
En vous créant, l’Éternel a souri. »
C’est dans le regret de la Grenadière qu’il a écrit ces vers, car il quitte ces lieux pour s’installer rue Chanoineau. Judith avec l’âge devient revêche et percluse de rhumatismes. Le propriétaire prête la clef du jardin pour ses chats. Très vite, rien ne va plus, les chats de Judith prennent la clef des champs, elle en est très affectée. Béranger se contente de chanter à sa façon leur caprice.
« Tu réveilles ta maîtresse,
Minette, par tes longs cris.
Est-ce la faim qui te presse ?
Entends-tu quelque souris ?
Tu veux fuir de ma chambrette,
Pour courir je ne sais où.
Mia-mia-ou ! Que veut Minette ?
Mia-mia-ou ! C’est un matou.
(…) » (Extrait de « La chatte »)
Béranger déménage donc encore une fois, rue du faubourg St Éloi (l’actuelle rue Jules Charpentier). Il y broie vite du noir. C’est à Tours qu’il entreprend d’écrire sa biographie qui ne sera publiée qu’après sa mort.
 Toutefois, c’est bien de son vivant, grâce à ses quatre années de séjour dans la ville de Tours, que le conseil municipal va décider en 1843 de nommer boulevard Béranger la partie du mail qui va à la barrière St Éloi. L’émoi d’une certaine partie de la population tourangelle n’approuve pas cet honneur rendu à un homme de son vivant !
Toutefois, c’est bien de son vivant, grâce à ses quatre années de séjour dans la ville de Tours, que le conseil municipal va décider en 1843 de nommer boulevard Béranger la partie du mail qui va à la barrière St Éloi. L’émoi d’une certaine partie de la population tourangelle n’approuve pas cet honneur rendu à un homme de son vivant !
Béranger est triste et désenchanté, le vieillissement lui pèse. C’est en Touraine qu’il écrit ces vers :
« Avec Dieu, bien souvent je cause,
Il m’écoute, et dans sa bonté,
Me répond toujours quelque chose
Qui, toujours me rend la gaîté.
Bien triste, un jour j’ose lui dire :
Je vois poindre mes soixante ans,
Des vers en moi le souffle expire,
De quelles fleurs parer le temps ?
Le vin rallume en nous la joie,
Mais bien que Dieu nous l’ait permis,
Que faire du peu qu’il m’envoie
Loin de tous mes bons vieux amis ?
Plus d’amour dans l’hiver de l’âge,
Mon cœur en vains soupirs se fond,
C’est le poisson qui toujours nage
Sous la glace d’un lac profond.
(…)
Oui le repos sur ce rivage
Voila, mon lot. Mais que le ciel
M’accorde un des plaisirs du sage :
Au pauvre ermite un peu de miel !
Dieu bon, avec toi ma tendresse
De tout mot pompeux se défend.
Dieu bon, pitié pour ma faiblesse,
Donne un jouet au vieil enfant ! »
C’est alors qu’un amour comme il n’en a jamais connu va bouleverser Béranger à l’âge de soixante ans ! On a longtemps pensé qu’il n’avait pas connu les amères inquiétudes, les folies et le déchirement de l’amour. Ce n’est pas le démon de midi qui le frappe, mais un venu d’Angleterre. Sainte-Beuve fait, dans ses « Nouveaux Lundis » un récit de cet enivrant amour si tardif.
Béranger voit fréquemment à Tours, deux dames anglaises. L’une est jeune et il s’aperçoit avec effroi qu’il s’en éprend comme jamais il ne l’a été dans toute sa vie.
 Il écrit à Bretonneau son médecin et son confident, que s’il quitte la Touraine, c’est sous le prétexte que sa compagne Judith s’ennuie loin de Paris.
Il écrit à Bretonneau son médecin et son confident, que s’il quitte la Touraine, c’est sous le prétexte que sa compagne Judith s’ennuie loin de Paris.
Il est difficile d’éluder cette mystérieuse histoire d’amour, car les avis sont contradictoires. Pourtant, s’installe une année bien énigmatique. Il part s’installer près de Vincennes dans un logis sous un nom d’emprunt. Une crise de solitude, ou plutôt une aventure amoureuse.
Car Judith ne le rejoindra qu’une fois, qu’il sera de nouveau installé à Paris ; où cette fois, il va vraiment vieillir tristement ! Il est adulé, mais les flatteries les plus insensées ne le grisent pas. Il écrit :
« Ah ! Que les vieux
Sont ennuyeux !
Malgré moi j’en grossis l’espèce -
Ah ! Que les vieux sont ennuyeux !
Ne rien faire est ce qu’ils font mieux ! »

À soixante-dix ans, Béranger se complaît dans la mélancolie. Il regrette le bon vieux temps. Lucide, il pense que son nom ne lui survivra pas.
Sa santé devient chancelante et il en fait part à Bretonneau le grand médecin de Tours qui le fait suivre par ses illustres élèves, Velpeau et surtout Trousseau.
Sa compagne Judith meurt en 1857. Béranger s’éteint trois mois plus tard.
Afin d’éviter tout incident, le gouvernement impérial ordonne des funérailles nationales. Béranger repose au Père-Lachaise. Un médaillon de bronze fait par David d’Angers, représente son visage au front chauve, aux cheveux ramenés vers la joue, au visage imberbe. Sur une plaque, on lit cette inscription :
Béranger, Poète National
Né à Paris le 19 Août 1780
Mort le 16 Juillet 1857
Comme il l’avait toujours pensé, après sa disparition, peu à peu les chanteurs des rues abandonnèrent ses couplets et ses refrains sur la liberté et la patrie.
Hécate




 terribles frissons, enveloppée dans le grand manteau de son mari, avec un grand chat couché sur son sein. Le couple avait en leur logis une chatte noire nommée Catterina. (Edgar préférait les chats de cette couleur). Cette bête merveilleuse refusait toute nourriture en l’absence de son maître.
terribles frissons, enveloppée dans le grand manteau de son mari, avec un grand chat couché sur son sein. Le couple avait en leur logis une chatte noire nommée Catterina. (Edgar préférait les chats de cette couleur). Cette bête merveilleuse refusait toute nourriture en l’absence de son maître.





 Je pensai à l’enfant qu’on avait trouvé dans la chambre de sa mère morte. Depuis combien de jours, gisait-elle ainsi, cette jeune femme de 24 ans qui chaque soir sur la scène vivait et mourrait, tour à tour Ophélie ou Juliette ? Combien de fois le petit Edgar avait-il guetté un possible réveil, cherchant une lueur de vie sous les paupières demi closes de la morte. Sa première morte…
Je pensai à l’enfant qu’on avait trouvé dans la chambre de sa mère morte. Depuis combien de jours, gisait-elle ainsi, cette jeune femme de 24 ans qui chaque soir sur la scène vivait et mourrait, tour à tour Ophélie ou Juliette ? Combien de fois le petit Edgar avait-il guetté un possible réveil, cherchant une lueur de vie sous les paupières demi closes de la morte. Sa première morte…




 ANNA DE NOAILLES
ANNA DE NOAILLES
 - " Nous menons ici la vie de province, la vie vénitienne, au café Florian où nous nous installons matin et soir, tandis que va, vient, boit et fume la petite notoriété littéraire de Venise. Douceur et tristesse de voir vivre et vieillir dans cette plus belle ville du monde, des êtres faibles et studieux qu'écrase la beauté de la ville."
- " Nous menons ici la vie de province, la vie vénitienne, au café Florian où nous nous installons matin et soir, tandis que va, vient, boit et fume la petite notoriété littéraire de Venise. Douceur et tristesse de voir vivre et vieillir dans cette plus belle ville du monde, des êtres faibles et studieux qu'écrase la beauté de la ville." 
 Depuis 1924, elle a noué avec Jean Cocteau une amitié fulgurante. Ils ont en commun la passion de la poésie, le don de la parole, la fascination de la mort qu'ils conjurent en en parlant sans cesse ; ils ont tous deux été élevés par une gouvernante allemande et, perdu leurs pères lorsqu'ils avaient dix ans.
Depuis 1924, elle a noué avec Jean Cocteau une amitié fulgurante. Ils ont en commun la passion de la poésie, le don de la parole, la fascination de la mort qu'ils conjurent en en parlant sans cesse ; ils ont tous deux été élevés par une gouvernante allemande et, perdu leurs pères lorsqu'ils avaient dix ans. 








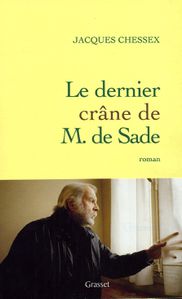
![Crane phreno[1]](http://img.over-blog.com/300x216/2/48/15/71/Crane_phreno-1-.jpg)


 Pierre Charras nous livre une voix chuchotant l’âme qui se désincarne, celle de Franz Schubert, simplifiant à l’extrême, ce que fut la vie de ce musicien bohème avant la lettre et qui ne vivait que pour satisfaire le démon intérieur qui le poussait à créer sans la moindre garantie matérielle.
Pierre Charras nous livre une voix chuchotant l’âme qui se désincarne, celle de Franz Schubert, simplifiant à l’extrême, ce que fut la vie de ce musicien bohème avant la lettre et qui ne vivait que pour satisfaire le démon intérieur qui le poussait à créer sans la moindre garantie matérielle. écoutés, aimés, ses cordes qu’il a su faire vibrer si profondément, non seulement dans le quatuor « La jeune fille et la mort », qu’illustra Moritz von Schwind à la mine de plomb sur papier jauni et que j’ai vue lors de l’exposition « L’Âge d’or du romantisme allemand» à l’époque de Goethe à Paris, moment d’indicible émotion…mais aussi l’Adagio du quintette pour deux violons alto et deux violoncelles en ut majeur composé l’année de sa mort, où frémit la fiévreuse tendresse d’une inquiétude sans mots !...
écoutés, aimés, ses cordes qu’il a su faire vibrer si profondément, non seulement dans le quatuor « La jeune fille et la mort », qu’illustra Moritz von Schwind à la mine de plomb sur papier jauni et que j’ai vue lors de l’exposition « L’Âge d’or du romantisme allemand» à l’époque de Goethe à Paris, moment d’indicible émotion…mais aussi l’Adagio du quintette pour deux violons alto et deux violoncelles en ut majeur composé l’année de sa mort, où frémit la fiévreuse tendresse d’une inquiétude sans mots !...